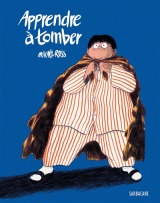Jean-Baptiste Coursaud, traducteur
Traducteur du norvégien, du danois et du suédois, éditeur d'auteurs germanophones de bande dessinée, expert des littératures jeunesse, Jean-Baptiste Coursaud a la passion de la langue vissée à l'âme et au corps. Ses tatouages de citations littéraires peuvent en attester, mais c'est en mots plutôt qu'en image que nous vous révèlerons son amour pour les langues, la traduction et la littérature.
Il a été membre de commission du CNL et certaines de ses traductions, plus de 150 à son actif, ont été soutenues. Découvrez le parcours de ce traducteur passionné et passionnant !
- Partager sur Twitter
- Partager sur Linkedin
- Partager sur Facebook
- Cliquer pour copier le lien de la page

Comment êtes-vous devenu traducteur ?
J’étais journalise, dans une autre vie, et voulais devenir critique de littérature jeunesse. C’est une littérature qui me tient profondément à cœur, même encore maintenant alors que je n’en traduis quasiment plus. Pour la petite histoire, c’est une littérature que j’ai connue grâce à deux auteurs que j’admirais plus jeune : Hervé Guibert et Christophe Donner. Ce sont deux figures littéraires dans laquelle je voyais une ligne de parenté. Et quand j’ai découvert les livres que Christophe Donner écrivait pour la jeunesse, pour Geneviève Brisac à l’École des Loisirs, j’ai découvert des romans merveilleux, des livres parfaits, comme peuvent l’être des romans qui ont trouvé leur langue, leur style et leur sujet.
C’est comme ça que j’ai découvert la littérature jeunesse, mais à l’époque devenir critique littéraire jeunesse était compliqué. Il y avait peu de rubriques dédiées dans la presse française. Autour de moi, les éditeurs ont rapidement appris que je parlais les langues scandinaves et me demandaient régulièrement si je ne voulais pas traduire ou faire des lectures pour eux. Ce à quoi je répondais que ce n’était éthiquement pas tenable. Je ne pouvais pas écrire des critiques et des recensions de leurs livres tout en travaillant pour eux. Jusqu’à ce que Geneviève Brisac me propose de traduire un livre pour l’École des Loisirs et là j’ai dit oui !
C’est quoi, pour vous, être traducteur ?
Je me suis très vite rendu compte que, moi qui avait toujours été dans l’écriture et le travail de la langue, des velléités littéraires de ma jeunesse à mon métier de journaliste, j’étais sans doute un piètre écrivain. Traduire était ce que je savais faire de mieux. De la même manière qu’aujourd’hui, je suis éditeur pour des auteurs et des autrices germanophones de bandes dessinées et c’est un métier que j’adore. Ce que je sais faire, c’est être le porte-parole d’une écriture existante. Or, je pense que le métier de traducteur, c’est ça. Un bon traducteur, c’est quelqu’un qui va avoir trouvé dans sa langue quelle langue aurait eu l’autrice ou l’auteur si il ou elle avait écrit dans la langue d’arrivée.
Le grand malentendu, le litige, du traducteur – pour l’avoir vécu – c’est de ne pas comprendre que tel mot, telle expression ou telle formulation peut, et parfois doit, se dire de manière complètement différente. Il faut s’éloigner de la langue traduite pour se rapprocher de sa langue maternelle. L’exemple typique ce sont ces mots qui se disent de la même manière, que l’on retrouve identiquement dans sa langue.
En norvégien "fantastique" se dit fantastisk sans dire tout à fait la même chose. Fantastisk signifie "merveilleux" et non pas nécessairement "fantastique". Ferdinand de Saussure explique que "mouton" et mutton en anglais ont un signifiant identique, mais un signifié différent : mutton c’est la pièce de mouton, le mouton que l’on trouve dans les rayons des supermarchés. Et c’est aussi comme ça que ce fait la traduction, dans le concret. Vous voyez un article de journal, vous lisez un livre, vous écoutez les informations à la radio, vous allez au supermarché et les mots apparaissent. Les mots sont dans le vivant, dans l’actuel. Au rayon surgelé du supermarché, je vois mutton, et ce n’est pas du mouton au sens où nous l’entendons en français. La traduction, c’est ça. Traduire le mot de façon plus ou moins identique au nôtre, c’est le piège le plus élémentaire et le plus simple qui puisse se présenter au traducteur.
"Déjouer les pièges de la traduction", est-ce une stimulation ou une motivation intellectuelle ?
C’est une bonne question ! Je crois que je vais y répondre en la contournant. Il y a des romans pour lesquels je crois que je ne suis pas le meilleur traducteur, tout ce qui n’est pas une littérature qui a d’une certaine manière un jeu avec la langue ne m’intéresse pas – et, en disant cela, je parle du romanesque ! « La route qui serpente dans la montagne boisée, à flanc de coteau… » C’est une torture de traduire ça, la phrase ne me parle pas. Et comme j’ai une nature hystérique – comme le teckel, je mors et ne lâche pas – je suis capable de rester une heure sur une phrase, jusqu’à trouver le bon mot. Et puis, je vérifie tout quand je traduis.
Comment vérifiez-vous ce que vous traduisez ?
D’abord, je regarde dans le dictionnaire bilingue – par exemple norvégien/français – puis dans le dictionnaire monolingue, celui de l’académie norvégienne. Ensuite, je vais vérifier dans le Trésor de la Langue Française. L’idée est chaque fois de délimiter le sens au maximum. Ensuite, je consulte la base Crisco qui est très précise, le Dictionnaire Electronique des Synonymes (DES) de l’Université de Caen. Après, j’ai environ 90 dictionnaires et lexiques papier, et autant en numérique, des vieux comme des récents. Je pense que chaque livre a son dictionnaire.
En ce moment, je traduis une autrice norvégienne et vais beaucoup aller vérifier dans le Grand dictionnaire de l’argot de Jean-Paul Colin (Larousse), mais il m’arrive, pour d’autres traductions, de consulter d’autres lexiques. Récemment, pour un livre que je traduis pour Evelyne Lagrange chez Zulma, je suis allé chercher des mots dans des dictionnaires de moyen et d’ancien français.
Je vais aussi sur un site très bien pour tout ce qui concerne la langue parlée et l’argot : le site "bob". Il recense toutes les formules argotiques de la langue parlée en permettant de faire des recherches à l’envers, du mot "classique" à l’argot, et propose un classement hiérarchique très utile. Toute la difficulté de la traduction, c’est justement de trouver le mot moins "classique". Peut-on dire "tailler la bout de gras" ? "Papoter" ? Est-ce que "papoter" est juste du point de vue de son emploi dans la langue française ? Est-ce qu’il convient au texte ? Et si cela ne convient pas, quel synonyme je peux employer selon le contexte ?
Cette problématique des niveaux de langue, je la vois avec Mikaël Ross qui travaille sur une bande dessinée sur le jeune Beethoven à paraître chez Dargaud – pour les 250 ans de la mort de Beethoven – dont j’ai traduit un extrait. Toute la difficulté est que Mikaël emploie une langue contemporaine. Il n’est pas dans l’historicisme, à vouloir retrouver la langue de l’époque. Néanmoins, le danger, sous couvert d’une écriture qui va vers la langue parlée, est d’aller trop dans le langage contemporain de la rue. Il faut trouver un entre-deux, une langue de la rue, ni trop datée ni trop moderne.
Traduire, c’est vieillir ?
Le langage parlé, la langue "vulgaire", vieillit plus vite dans sa traduction que dans sa langue originale. "Diantre", que tout locuteur identifie comme un mot du français classique, écrit par un auteur français dans son roman vieillira moins vite que si je l’utilise dans ma traduction. C’est la même chose avec le langage de la rue.
L’exemple typique en traduction, c’est Ragazzi de Pier Paolo Pasolini. Il a écrit Ragazzi en dialecte romain et le traducteur, dans les années 1950-60, a voulu respecter cette particularité linguistique. Pour trouver en français ce qui marque cette différence entre l’italien littéraire et l’italien parlé de Rome, il a décidé d’utiliser l’argot. D’un pur point de vue "traductionnel", il a eu entièrement raison, sauf qu’aujourd’hui quand vous lisez la traduction de l’époque, vous ne comprenez rien, c’est illisible ! L’argot qu’il utilise ne nous dit plus rien aujourd’hui.
Lorsque l’on est dans un langage ultra-contemporain, un lexique très « souligné », je me demande sans cesse : quels choix je vais faire comme traducteur pour ne pas que ma traduction devienne illisible dans 10 ans ?
Traduire des livres de formats et de genres divers : est-ce le même travail ?
J’ai la même exigence quel que soit le travail et le genre de littérature. Le même plaisir aussi, car on ne traduit bien que ce qu’on aime bien. Mais vous avez certaines différences. Par exemple, dans le roman on peut "tromper" le lecteur en utilisant des périphrases. Un mot ou un phénomène qui n’a pas d’équivalent peut-être traduit avec une périphrase. Au théâtre et dans la bande dessinée par exemple, ce n’est pas possible, on est dans l’immédiateté, dans une langue qui est plus ramassée et le traducteur doit renoncer aux artifices auxquels il peut avoir recours dans le roman.
Comment abordez-vous la lecture de vos futures traductions ?
La meilleure des traductions serait la toute première lecture.
Quand je lis un roman étranger que je vais traduire, au bout d’une page, comme en écho, il y a une voix française qui résonne dans ma tête. Et cette voix ne réapparaît pas quand je commence le travail de traduction, trois, dix, douze ou dix-huit mois après. Elle est partie. Il y a dans cette lecture "naïve", sans traitement, genuine dirait-on en anglais, une fraîcheur ou une originalité que l’on ne va jamais retrouver, quelle que soit la lecture que l’on fait ensuite du roman.
En ce moment, je lis un roman de l'écrivaine danoise Kristina Stoltz. J’entends la voix française de Kristina, mais je ne vais pas le traduire avant un an et cette voix sera perdue, elle ne reviendra pas. Il faudrait ne pas avoir lu le roman et, au moment où on commence à le traduire, le lire pour la première fois. Et en même temps ce n’est pas possible, vous n’allez pas signer un contrat de traduction pour un roman que vous n’avez pas lu, sans savoir s’il vous plaît et si vous êtes la bonne personne pour le traduire. Vous êtes obligé de le lire. Il faudrait inventer une machine connectée au cerveau qui puisse capter cette voix qui résonne à la première lecture !
Et ce n’est pas une question d’auteurs dont on connaît l'œuvre pour avoir traduit plusieurs de leurs livres. Vous savez, le plus difficile c’est de traduire un nouvel auteur ou une nouvelle autrice. Quand vous avez traduit deux, trois, romans, c’est plus simple que le premier. Pour l'anecdote, j'aimerais parler de l'immense Sara Stridsberg, dont j'ai traduit tous les romans et qui est une amie, dans la mesure où elle constitue une exception à ce que je viens de dire. Quand je la traduis, les mots en français viennent tout seuls, comme si Sara avait initialement écrit son roman en français, lequel aurait ensuite été traduit et publié en suédois, si bien que ma tâche consisterait à le remettre dans ce français original. C'est une expérience très étrange que je n'ai avec aucune autre autrice ou auteur et je ne me l'explique pas.
Comment et depuis quand connaissez-vous le CNL ?
Je connais le CNL depuis toujours ! J’ai fait partie de la commission jeunesse entre 2003 et 2006 et suis toujours lecteur pour cette commission sur les littératures scandinaves.
Qu’est-ce qui vous a frappé dans le travail de la commission ?
C’est peut-être mon côté allemand, mais ce qui est essentiel pour moi, c’est cette notion d’argent public. C’est ce que je trouve fantastique en France, que l’État débloque de l’argent public pour aider la création. Et, en tant que collaborateurs directs ou indirects du CNL, ça nous oblige. Quand on me demande un rapport sur tel ou tel livre, il n’y a pas que le seul critère de savoir si la traduction est juste ou non, on nous demande d’autres choses. Par exemple, est-ce que telle aide est appropriée à tel éditeur ? C'est en ce sens que ça nous oblige, c’est de l’argent public qui va à la création et doit aller à la création.
De tout ce que j’ai pu vivre au sein de la commission jeunesse, c’est l'attribution d'une bourse d'écriture à Malika Ferdjoukh qui m'a le plus marquée. Je crois qu’elle a mis plusieurs années avant d’écrire et, du strict point de vue du règlement des aides du CNL, c’est de l’argent perdu. Pourtant, le CNL a aidé une autrice qui, certes a mis plusieurs années à produire son œuvre, mais sa tétralogie est désormais un classique de la littérature jeunesse. Quatre sœurs (L’École des loisirs) a été adapté en BD (Rue de Sèvres), c’est un roman graphique passionnant ! C’est là où l’ingéniosité du CNL doit être entendue.
À certains moments, le CNL aide vraiment des créateurs et des créatrices qui connaissent des difficultés, qu’elles soient financières ou intellectuelles, de vie ou de création, et même si le bénéficiaire ne crée pas dans l’année, il peut arriver à produire des chefs d’œuvre dans les deux ou trois années suivantes, et des chefs d’œuvre qui vont devenir des classiques. Et ça, ce n’est pas rien ! C’est toute la raison d’être du CNL.